Carl Christian Friedrich Kielmaier
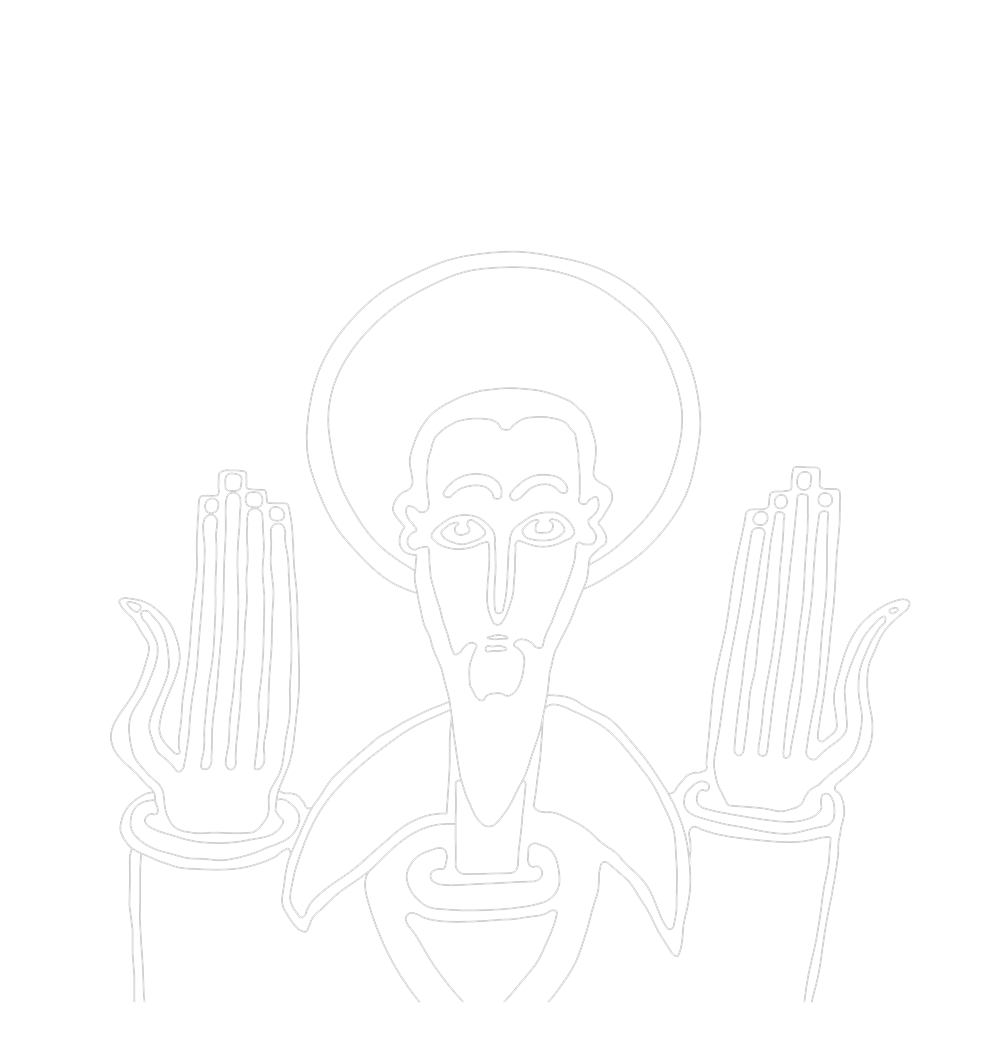
Carl Christian Friedrich Kielmaier
Le Wurtembergeois Carl Christian Friedrich Kielmaier est un ex-lieutenant de l’armée prussienne, né le 24 décembre 1805 à Schorndorf et mort en Éthiopie en 1840[1]. Les études éthiopiennes n’ont pas exploité à leur juste valeur les témoignages de ce voyageur comme le montre notre survol des bibliographies, relégué en note de bas de page pour ne pas vous bassiner[2]. La seule biographie disponible est celle d’Adolf Palm mais malheureusement sans grand ’aide pour l’épisode éthiopien[3].
Les témoignages de Kielmaier
Kielmaier a publié deux textes importants. Le premier « Nachrichten über Abyssinien » paraît en plusieurs livraisons dans le journal Das Ausland : Wochenschrift für Erd- und Völkerkunde, la 1ère livraison se trouvant dans le n° 319 du 15 novembre 1839. Il rend compte de son séjour au Tigré du 17 mai 1838 à fin avril 1838, date à laquelle le rapport est rédigé à Suez. Le deuxième texte « Notizen über das östliche Afrika » paraît dans le même journal à partir du n° 71 du 11 mars 1840. Il a été rédigé à Zayla au mois de novembre 1839 et contient les renseignements sur la région de Zayla recueillis dans cette ville.
Kielmaier au Tigré
Comment Kielmaier en vient à se rendre en Éthiopie n’est pas dévoilé par les sources consultées. Ceci dit, le fait qu’il soit un ancien militaire et originaire de la même région que les missionnaires Johann Ludwig Krapf et Karl Heinrich Blumhardt a certainement joué un rôle. Il arrive à Adua le 17 mai 1837[4], six mois après le départ de von Katte, précise-t-il. Soit dit en passant, il tiendra à apporter quelques rectifications au témoignage que le baron Karl Friedrich Rudolf Albo von Katte publie en 1838, Reise in Abyssinien im Jahre 1836. Certes l’officier Katte a dû abandonner son projet de la traversée de l’Éthiopie d’est en ouest faute d’argent et de renseignements fiables mais Kielmaier ne va pas moins déchanter car son intention d’entraîner les troupes du däğğazmač Wəbe Haylä Maryam pour faire face à celles de Mohammed Ali et accessoirement réduire l’anarchie dans laquelle se trouve le pays s’avère tout autant utopique. Pour être tout à fait complet, il faut évoquer l’arrivée à Adoua, au mois de janvier 1837, du botaniste bavarois Georg Wilhelm Schimper qui terminera son existence dans cette même ville 41 ans plus tard. Kielmaier fait sa connaissance et l’accompagne dans ses explorations botaniques. D’autre part, Kielmaier dit avoir fait trois fois l’aller-retour Adoua-Massaoua pendant son séjour. Ce sont en résumé les seuls renseignements qu’il livre sur son activité. Il faut donc en déduire qu’il ne s’éloigne pas des missionnaires protestants Karl Wilhelm Isenberg – et son épouse – et Karl Heinrich Blumhardt. Par contre, il est plus loquace sur les actualités locales, ce qui n’est pas pour nous déplaire.
Adoua en 1837
À Adoua, le mois de juin 1837 est chargé en visites impromptues. En effet, un capitaine anglais dénommé Thorn – à investiguer –, accompagné d’un menuisier wurtembergeois répondant au patronyme Keller pointent leur nez à Adoua. Le premier ne reste que quatre mois, achète des mules qu’il s’en va embarquer à Massaoua. Le menuisier Keller entre au service d’Isenberg. Des Anglais, des Allemands, ne manquaient que les Français. Le médecin Louis Rémy Aubert et l’ex-officier d’état-major Jules-Nicolas Dufey viennent grossir les rangs des Européens. Pour couronner le tout, une ambassade du negus du Choa Sahlä Səlasse arrive le 19 juin remettre l’invitation du Suzerain aux missionnaires à se rendre dans son pays.
Plus personnel, les mois de juin et de juillet mettent à l’épreuve le couple Isenberg qui perd deux enfants.
L’ambassade choanne s’en retourne au mois d’octobre avec la réponse encourageante d’Isenberg et de Blumhardt.
Au mois de novembre, le missionnaire Johann Ludwig Krapf vient renforcer la mission protestante d’Adoua[5].
Adoua en 1838
Le premier mois de l’année 1838 voit Aubert quitter l’Éthiopie et se rendre en Égypte alors que son compère Dufey prévoit de se rendre au Choa.
Arrive le mémorable mois de mars 1838 lorsque le däğğazmač Wəbe Haylä Maryam décide de faire de l’ordre et d’expulser les missionnaires protestants en y incluant par la même occasion Kielmaier, Keller et Schimper. Concomitant arrivent le 1er mars deux voyageurs, indigents mais fameux, le basque Arnauld d’Abbadie et le missionnaire lazariste Giuseppe Sapeto. Antoine d’Abbadie garde les bagages à Massaoua. La consternation a dû se lire sur le visage des missionnaires protestants.
Le 13 mars, contraints par le Suzerain du Tigré, Isenberg, Blumhardt et Krapf abandonnent la mission qu’ils ont bâtie et quittent le pays par Massaoua. Kielmaier, Keller et Schimper sont en sursis grâce à l’argent, les armes et les autres cadeaux que ce dernier à fait à Wəbe. Notre lieutenant est donc aux premières loges pour assister en au pillage de la mission et ne se prive pas d’en rendre compte.
Le 17 mars, Arnauld retourne à Massaoua chercher son frère Antoine et laisse Sapeto montrer patte blanche dans les lieux de culte. La caravane composée d’une trentaine de personnes peine à résister à la cupidité des chefs locaux. Pour parcourir la distance qui sépare Halay d’Adoua, elle prend un mois alors qu’ordinairement elle est parcourue en trois jours[6]. Avec deux fusils de rempart, Arnauld graisse la patte de Wəbe pour obtenir l’autorisation de poursuivre avec son frère vers Gondar[7]. Le 21 mai, les frères d’Abbadie se séparent de Sapeto qui reste à Adoua, trop content d’avoir été adopté par les autochtones[8].
Antoine d’Abbadie et Kielmaier ont dû faire connaissance pendant ce mois-là comme en témoigne la lettre d’Antoine datée du 1er septembre 1840, à Aden, dans laquelle il dit avoir apprécié ce voyageur habitué aux conditions d’un voyage en Afrique, de surcroît parlant l’arabe et l’amharique.
Fin avril 1838, Kielmaier se résigne à quitter l’Éthiopie sans préciser ce que Keller devient. Schimper, lui, est autorisé à rester.
Trop tardivement, l’ambassade de Sahlä Səlasse arrive au mois de mai pour emmener les missionnaires et doit s’en retourner bredouille ; enfin pas tout à fait puisque, chemin faisant, elle emmène avec elle Dufey.
Changement de cap
En maintenant notre attention sur les missionnaires protestants, notre regard doit se tourner vers le Caire.
Au mois de septembre 1838, Krapf retrouve la famille Isenberg et l’officier Kielmaier au Caire[9]. Il est décidé que Krapf et Isenberg entreront au Choa et qu’ils seront suivis par Kielmaier et Charles-Xavier Rochet d’Héricourt. Comme si cela était tout à fait évident, Krapf ne prend pas la peine d’expliquer comment cette association surprenante a pris forme. Dans les faits, les missionnaires laissent le Caire derrière eux au mois de janvier 1839, tentent leur chance à Zayla pour finalement aboutir à Tadjoura. Le lecteur moderne ne sera pas surpris d’apprendre qu’ils ne pourront quitter la côte maritime que le 27 avril, passeront l’Awash le 29 mai et sont finalement reçus par le negus Sahlä Səlasse le 6 juin à Angolala.
Cinq mois plus tard, un chassé-croisé a lieu : Isenberg retourne en Europe s’occuper d’éditions amhariques et Rochet arrive, seul. En effet, suite à une dispute avec Kielmaier, ce dernier est resté à Aden pour s’équiper et a laissé Rochet continuer seul son chemin[10].
Kielmaier à Aden
En 1839, Aden a perdu de sa grandeur et ne consiste plus qu’en un petit village, pauvre et négligé[11]. Déjà en 1820, le capitaine Haines était en tractations avec les possesseurs d’Aden, les Sultans de Lahej de la famille Abdali. En janvier 1839, les Britanniques prennent la ville par la force, constituant la première nouvelle acquisition territoriale du règne de la reine Victoria. Logiquement, Haines obtient le poste de Political Agent britannique à Aden[12]. Au mois de novembre, il doit faire face à une tentative de reprise d’Aden par une coalition des Abdali et des Fadhli, les deux sultanats du sud de la péninsule arabique.
Concernant cette année-là, Rubenson découvre dans les archives du Foreign Office que l’officier allemand a soumis une requête au capitaine Haines. À condition qu’il parvienne à réaliser son projet militaire au Choa, il demande à la Grande-Bretagne de lui fournir du « matériel militaire ». La réponse du gouvernement de Bombay n’est pas connue par Rubenson. Cependant, nous savons que Kielmaier traverse le Golf d’Aden et tente de rejoindre Krapf par Zayla. En effet, rappelons-nous que le deuxième texte de Kielmaier est daté de novembre 1839, approximativement quand Rochet arrive au Choa. Les informations qui nous sont parvenues concordent.
Notice sur la l’Afrique orientale
Kielmaier se cantonne à Zayla qui n’est pas un port à proprement parler puisqu’un navire de 250 tonnes ne peut pas y accoster mais l’agglomération maritime la plus proche de Harar. La rivalité entre la France et la Grande-Bretagne n’est pas étrangère à l’intérêt que les deux puissances portent à Zayla[13]. Selon Kielmaier, elle est pour l’instant du ressort de l’Égypte, autrement dit du pacha Mohamed Ali et gouvernée depuis Mocha. L’émir paie 500 thalers annuels au premier et entre 200 et 300 au second. Concernant Harar, il confirme que les noms des stations entre Zayla et Harar qui figurent sur les cartes sont corrects. De quelles cartes parle-t-il ? Le choix ne doit pas être grand en 1839 ! Ensuite, il traite des deux itinéraires qui mènent à Harar et qui partent de Berbera et Zayla. Une caravane prend 4 à 5 mois pour parcourir le premier, un homme seul sans bagage ne prendra que 4 à 5 jours ; alors que le deuxième itinéraire sera parcouru en 2 à 3 mois et 2 à 3 jours. De ce renseignement, on peut donc partir du principe que le sultan de Harar peut être informé en quelques jours de l’arrivée d’un navire.
À propos du sultan, celui qui règne sur la ville depuis sept ans s’appelle Abu Bekr. Kielmaier nous rapporte deux anecdotes dont une ayant trait à un Européen qui, à Harar, tombe dans une embuscade tendue par le Sultan. Il serait par conséquent le premier Occidental à y entrer, malheureusement sans en ressortir, ce que Richard Francis Burton fera mieux 15 ans plus tard[14].
Kielmaier termine son rapport par un vocabulaire, de mots et de chiffres, en allemand, schiho, danakäl, sómal, harrer et galla, certes modeste mais à notre sens significatif. Cette approche studieuse explique pourquoi Antoine d’Abbadie ne pensera de Kielmaier que du bien.
Tadjoura : fin de parcours
Il est fort probable que les renseignements glanés à Zayla l’ont dissuadé d’en faire son point de départ pour rejoindre le Choa. Il a dû se résigner à rejoindre Tadjoura et subir les mêmes tracasseries que ses prédécesseurs. Malheureusement pour lui, sur le chemin, la fièvre et la dysenterie auront raison de son opiniâtreté[15].
Krapf apprend la nouvelle de la mort de son compatriote le 27 mai 1840[16]. Son serviteur, un certain Samuel Georgis, n’est pas encore apparu avec les bagages du défunt. Faut il en déduire que le drame s’est passé il y a tout au plus quelques semaines ? Ce qui nous mènerait à une mort au début du mois de mai. En admettant qu’il ait pris un mois pour organiser sa caravane, il serait à Tadjoura depuis le mois d’avril. Les informations manquent pour préciser ce que Kielmaier fait entre novembre 1839, date à laquelle il termine sa note à Zayla et le mois d’avril suivant. Heureusement, Rochet rend compte chronologiquement de ses faits et gestes. Sachant que le 20 avril il frète pour Aden, passe par Zayla et atteint sa destination le 2 mai, on peut raisonnablement en déduire qu’il ne peut avoir ignoré toute information concernant soit la mort de Kielmaier en amont de Tadjoura, soit sa présence à Zayla. La première hypothèse n’est pas soutenable car elle impliquerait une mort de Kielmaier au mois d’avril. La deuxième hypothèse signifierait que Rochet a croisé Kielmaier à Zayla et qu’il a passé la rencontre sous silence.
Le 1er septembre 1840, une lettre d’Antoine d’Abbadie mentionne avec regret la mort de Kielmaier sur le trajet Tadjoura-Ankober. Das Ausland informe ses lecteurs dans les Miscellen du numéro 13, daté du 6 novembre 1840 en citant la lettre d’Antoine Abbadie au journal Athenäum.
Biblethiophile, 14.08.2025
[1] Dénommé Kielmaier, parfois précédé du C, son nom complet est révélé par HEYD (Wilhelm), Bibliographie der württembergischen Geschichte, p. 462.
[2] Il manque à FUMAGALLI (Giuseppe), Bibliografia etiopica. Catalogo descrittivo e ragionato degli scritti pubblicati dalla invenzione della stampa fino a tutto il 1891 intorno alla etiopia e regioni limitrofe; l’EAe ne lui a pas prévu d’article ; PANKHURST (Rita & Richard), « A select annotated bibliography of travel books on Ethiopia » ne l’a pas retenu en raison probablement de sa publication dans les journaux ; RUBENSON (Sven), The Survival of Ethiopian Independence reconnaît l’existence de Kielmaier mais semble ignorer ses témoignages ; MARCUS (Harold G.), The Modern History of Ethiopia and the Horn of Africa: A Select and Annotated Bibliography ne connaît que la première contribution de Kielmaier ; WAGNER (Ewald), Harar. Annotierte Bibliographie zum Schriftum über die Stadt und den Islam in Südostäthiopien, conformément au sujet traité ne liste que la deuxième contribution ; LOCKOT (Hans Wilhelm), Bibliographia Aethiopica: die Aethiopienkundliche Literatur des deutschsprachigen Raums, est le plus complet.
[3] PALM (Adolf), « Carl Christian Friedrich Kielmaier », in TADDEY (Gerhard), Lebensbilder aus Schwaben und Franken, W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1991, pp. 68-89.
[4] Le récit de Kielmaier ne mentionne que le mois, le jour est cité par un autre article du journal Das Ausland.
[5] Krapf annonce une arrivée à Massaoua au mois de décembre 1837 dans Reisen in Ost-Afrika ausgeführt in den Jahren 1837-55. Zur Beförderung der ostafrikanischen Erd- und Missionskunde, p. 32.
[6] ABBADIE (Arnauld, d’), Douze ans de séjour dans la Haute-Éthiopie (Abyssinie), p. 33.
[7] Ibid., p. 38
[8] Ibid., p. 41
[9] Krapf, Reisen, op. cit., p. 41.
[10] Ibid., p. 49.
[11] L’histoire d’Aden se base principalement sur HUNTER (F[rederick] M[ercer]), An Account of the British Settlement of Aden in Arabia, p. 165.
[12] Voir la liste chronologique des agents dans GAVIN (R. J.), Aden under Britisch Rule 1839-1967.
[13] Voir les deux articles de GORI (Alessandro), « Zayla » et de MORIN (Didier), « Zayla in the 19th and 20th centuries », EAe, t. 5, resp. p. 164 et p. 166.
[14] Voir le résumé qu’en donne WAGNER (Ewald), Harar. Annotierte Bibliographie zum Schriftum über die Stadt und den Islam in Südostäthiopien, référence 06.47, p. 65.
[15] Krapf, Reisen, op. cit., p. 50.
[16] ISENBERG (Carl Wilhelm) & KRAPF (Johann Ludwig), Journals of the Rev. Messrs. Isenberg and Krapf, missionaries of the Church Missionary Society, detailing their proceedings in the Kingdom of Shoa and journeys in other parts of Abyssinia in the years 1839,1840,1841, and 1842 to which is prefixed a geographical memoir of Abyssinia and South-Eastern Africa, by James M’Queen, Esq. grounded on the Missionaries’ journals, and the expedition of the Pacha of Egypt up the Nile, p. 247.