Les signataires du traité conclu entre la France et le sultan de Tadjourah, pour l’abolition de l’esclavage [20 janvier 1890].


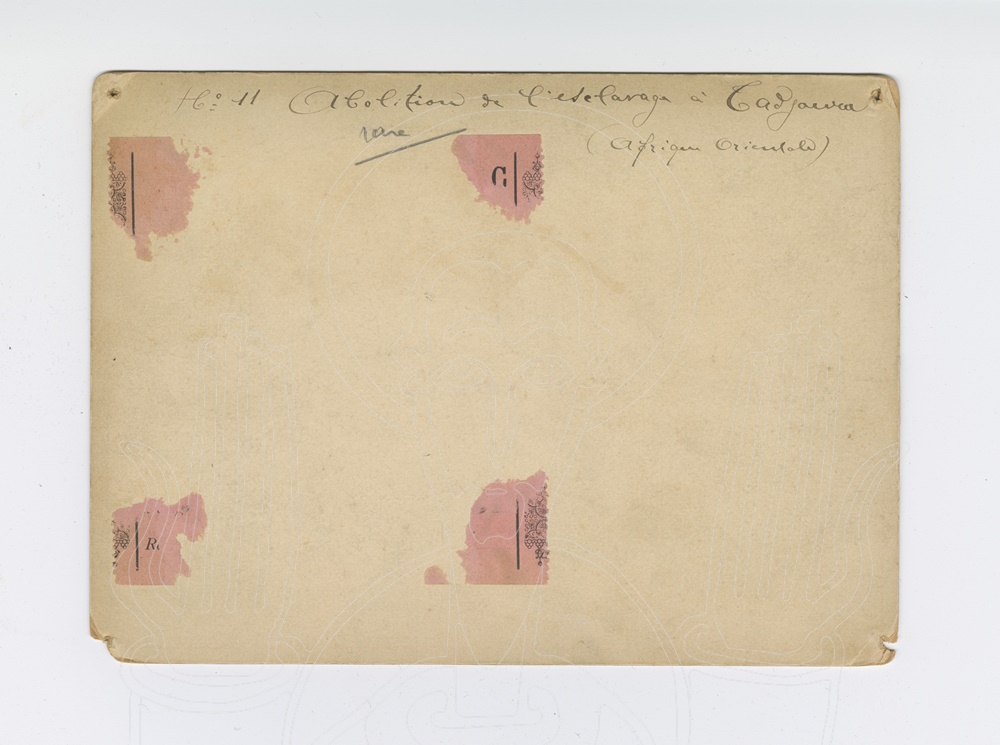
Édition
Éditeur : s.n.
Lieu : Tadjoura
Année : 1890
Description
État du document : bon
Références
Réf. Biblethiophile : 004707
Réf. UGS : 4101000
Première entrée : 1890
Sortie définitive : 1890
COLLATION :
Tirage albuminé (12 x 17 cm) collé sur carton.
En savoir plus
Le tirage
Tirage albuminé (12 x 17 cm) collé sur carton encadré d’un filet rouge. Au recto, une flèche et une croix montre l’Européens casqué assis à la gauche de Lagarde. Une mention manuscrite « ?N° 11 » à été apportée sur le filet. Ce numéro est répété au dos, complété de la mention « Abolition de l’esclavage à Tadjoura (Afrique Orientale ». D’une autre main le mot « rare ». Le retrait d’une étiquette en papier a laissé quatre traces de collage aux angles.
Le seul exemplaire connu à ce jour se trouvait dans la collection de Pierre Leroy mise en vente le 27 juin 2007 chez Sotheby’s. Il faisait partie d’un lot de « 17 photographies originales toutes prises à l’époque même de Rimbaud » et portait la légende : « Abolition de l’esclavage – Tadjourah. Tirage cyanotype. Photographe non identifié. 13 x 18 cm »[1].
Une gravure d’après cette photo illustre l’article de Nils de Callières intitulé « L’abolition de l’esclavage à Tadjourah », paru entre en 1890 dans l’Illustré[2]. Il nous apprend que « l’administrateur colonial, L. Henry, envoyé, en octobre dernier, auprès du sultan de Tadjourah, posa les bases d’un traité par lequel l’esclavage était supprimé dans le sultanat […]. Signé, le 29 octobre 1889, […] le traité fut ratifié solennellement le 20 janvier dernier par M. le gouverneur Lagarde, venu à Tadjourah pour la circonstance ».
La gravure est légendée : « Les signataires du traité conclu entre la France et le sultan de Tadjourah, pour l’abolition de l’esclavage ». Elle indique le nom des signataires, listé ci-dessous, de gauche à droite en respectant la position de la première lettre :
| Cheick-Kassim | président du Grand-conseil. |
| Abou Baker | caïd de Tadjourah. |
| Hassem-Banabilla | caïd d’Obock. |
| Hamed-ben-Mohammed | sultan de Tadjourah. |
| M. Lagarde | gouverneur d’Obock. |
| M. de St-Vincent | chef de cabinet du gouverneur. |
| M. L. Henry | administrateur colonial. |
Le contexte
En 1890, Léonce Lagarde, gouverneur d’Obock depuis 1884[3], s’est déjà rendu à l’évidence que la rade d’Obock s’avérait moins bonne que prévue ; que l’arrière pays interdisait toute possibilité de relier Obock à l’Éthiopie par un chemin de fer et que la rade d’en face, dans le pays des Somalis-Issas, convenait mieux[4]. Philippe Oberlé nous confie les trois dates charnières à retenir:
En 1888 le gouverneur Lagarde se transporta à Djibouti avec son administration. Le transfert officiel n’eut toutefois lieu qu’en 1892. En 1896 enfin, un décret donnait au territoire le nom officiel de « Côte française des Somalis et dépendances[5].
Concernant ce déménagement, Lukian Prijac, quant à lui, s’interroge si l’esclavage n’aurait pas fait pencher la balance :
En raison de son manque de moyen financier, Lagarde n’est pas en mesure de compenser les revenus du dardár[6] de Tadjoura qui touche une taxe sur chaque esclave qui passe sur son territoire[7].
Le fait d’avoir déplacé le centre de gravité politique de la colonie sur la côte sud, sur laquelle ce fléau est moins voyant, n’est-il pas une des raisons de la création de Djibouti ?[8].
Il rapporte qu’à l’été 1889, donc quelques mois avant que les bases du traité ne soient posées, une caravane de 500 esclaves arrive à Tajourah en toute impunité[9]. Le pied de nez démontre qui commande réellement la région.
Depuis la fin des années 1830 et pendant tout le XIXe siècle, les conquêtes territoriales, la lutte contre le trafic d’armes, et la répression de l’esclavage n’ont pas cessé d’opposer l’Angleterre et la France. L’abolition de l’esclavage est utilisée comme prétexte à toutes sortes de manifestations et débouche à la XIXe siècle sur un échec patent : la répression de la traite humaine est une « utopie coloniale », une expression empruntée à Lukian Prijac.
Pour en revenir à notre cliché du 20 janvier 1890, Lagarde ratifie donc un traité sachant pertinemment que le trafic d’êtres humains est loin d’être éradiqué dans la région et espère pouvoir mieux fermer les yeux à Djibouti.
La convention
Les Archives nationales d’outre-mer possèdent la convention signée le 28 octobre 1889 à Djibouti[10]. Elle contient les articles suivants[11] :
28 octobre 1889
Convention relative à la répression de la traite des esclaves dans le Sultanat de Tadjourah.
Entre S.A. le sultan Homed ben Mohamed, sultan de Tadjourah, agissant en son nom, au nom du vizir héritier et de ses successeurs, assisté du président du Grand Conseil et des notables du pays.
Et Monsieur Lagarde (A.M.J.L.) Gouverneur de la colonie d’Obock et Dépendances
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
L’esclavage sous n’importe quelle forme est et demeure aboli dans le sultanat de Tadjourah.
Désormais, tout esclave arrivant sur le territoire du sultanat sera libre de plein droit et sera conduit aux autorités françaises pour être inscrit sur les registres de recensement.
Une récompense spéciale sera accordée à tous ceux qui auront fait preuve de zèle dans l’exécution de cette prescription.
Article 2
Afin d’empêcher la contrebande, tout propriétaire de boutre dans le sultanat sera tenu de faire inscrire ses embarcations au Gouvernement d’Obock et ne pourra les envoyer hors du golfe qu’après avoir fait viser leur carnet de bord.
Les nacoudas, au retour, seront également tenus de s’arrêter à Obock pour y faire viser leur patente et leurs livres de bord.
Article 3
Toute embarcation, dépendant du sultanat, qui aura servi à la contrebande de la traite pourra être saisie à quelque moment que ce soit par les autorités françaises et l’équipage rigoureusement puni.
Article 4
Toute personne qui aura connaissance de la présence clandestine d’esclaves sur le territoire du sultanat, ou celui de la colonie ou sur des embarcations quelconques sera tenue d’en informer les autorités françaises, sous peine d’être punie comme complice.
Article 5
Dans le cas où des habitants du Sultanat se préteraient à la fraude ou mettraient le trouble dans le pays, l’expulsion pourra être prononcée contre eux sans préjudice des peines plus graves qui leur seraient appliquées, s’il y avait lieu.
Article 6
Le sultan, le vizir héritier ainsi que les notables se reconnaissent responsables de l’exécution de la présente convention qui sera mise immédiatement en vigueur et déclarent se soumettre à toutes les mesures que croiront devoir prendre à cet effet les autorités françaises.
Article 7
De son côté, afin de reconnaître les sentiments d’amitié et de loyauté de S.A. le Sultan, le Gouvernement de la République s’engage à lui continuer sa bienveillance et à aider, dans la mesure du possible à la prospérité du sultanat et au développement de ses ressources.
Fait et signé à Jibouti le 28 octobre 1889.
Les signataires
[…] ben Ahmed, Cadi
Le vizir Mohammed Ibrahim
Le Sultan Homed ben Mohammed
Reïs El Medjlis
Signature illisible (par déduction, L. Henry, tampon : Gouvernement Colonie d’Obock)
[…] Chehem Sadik
Kassem Sahieh
Kamel Abou Beker
Sahieh Alouan
Sahieh Daoud
Ibrahim Abou Beker
Chououd
Bourhane Bey (tampon : Bourhane Bey – Bey de Jibouti)
El Hadj Lotof Hussin
El Hadj Dida
Hasan Banebila
Quelque signataires apparaissent dans la littérature.
Léonce Lagarde : ceux qui n’ont pas la chance de posséder le portrait qu’en fait Lukian Prijac se rabattront sur la page wikipeda.
Léon, Edmond Henry : (1863- ?) drogman honoraire au consulat de France à Aden. Fils du précédent. Détaché à Obock comme traducteur auprès de Lagarde. Parle arabe, indien, somali, anglais et italien. Selon Lagarde dans un bulletin individuel de notes: « M. Henry s’acquitte des délicates fonctions qui lui sont confiées avec le plus grand zèle et une grande maturité d’esprit. En différentes occasions il a montré le courage le plus déterminé et a été blessé l’année dernière [1888] dans une émeute suscitée par les étrangers. Au moment de l’occupation de Tadjourah ses services ont été inappréciables et dans les récentes affaires sa connaissance du pays m’a beaucoup aidé. Il est chef du service des renseignements de la colonie et grâce à lui tous les complots ourdis contre nous ont été jusqu’à ce jour déjoués. » A écrit un fascicule de français-somali (Imprimerie Nationale, 1896). C’est lui qui fut pressenti par son père pour le remplacer comme vice-consul de France à Zeyla début janvier 1887. Mais refusé par Paris. En 1889, il sera un des témoins (photo à l’appui) de la convention contre l’esclavage entre le sultan de Tadjoura et l’administration française. À la création de Djibouti, il sera administrateur de la ville (1890). [Scr.: ANOM, AP 139. Bulletin individuel de notes, 01.10.1889.][12]
Léon Henri figure sur la photo de groupe publiée par Hugues Fontaine dans Obock-Tadjoura. Années 1880[13]. Il est de blanc vêtu, debout, tout à droite.
Homed ben Mohammed : Ḥummad b. Maḥámmad b. Mandáytu, dardár de Tadjoura de 1880 à 1912[14]. La gravure figurant dans l’article « Observations ethnographiques sur les Danakils du Golfe de Tadjoura » est d’après une photographie du Dr Lionel Faurot, prise en 1886. On le voit également sur une photo de groupe et en portrait dans Obock-Tadjoura. Années 1880[15].
Mohammed Ibrahim : Maḥámmad b. Arbâhim, vizir du dardár de Tadjoura depuis 1887[16].
Bourhane Bey : Burhan Abû-Bakr (1855-1921), fils d’Abû-Bakr pasha et d’une femme d’origine somalie, d’une famille de sayyid de Zeyla. Premier chef du village de Djibouti désigné par Lagarde en 1888. Plus connu sous le nom de Burhán bey[17]. Il a dix frères : Ibrâhim, Maḥámmad, Ḥúmmad, Kâmil, Mákki, Mūsá, Adbulqâdir, Ḥusên, Ali, Ridwân[18].
Kamel Abou Beker : un des frères de Burhan Abû-Bakr (cf. Bourhane Bey ci-dessus) ?
Ibrahim Abou Beker : l’ainé des frères de Burhan Abû-Bakr (cf. Bourhane Bey ci-dessus) ?
Le photographe
Il aurait été si agréable d’attribuer ce témoignage photographique à Édouard Bidault de Glatigné. Malheureusement, celui-ci était déjà rentré en France. Nous sommes à l’écoute de vos suggestions !
Biblethiophile, 19.09.2025
[1] Mes remerciements à Hugues Fontaine qui m’a communiqué cette information et fourni une copie de la photo.
[2] Illustration, n° 2453 du 1er mars 1890.
[3] OBERLÉ (Philippe), Afars et Somalis. Le dossier de Djibouti, p. 69.
[4] Ibid., p. 72
[5] OBERLÉ, Afars, op. cit., p. 73.
[6] Titre des sultans Ad’áli de Tadjoura et des chefs Ankālá, cf. MORIN (Didier), Dictionnaire historique afar (1288-1982), p. 133.
[7] PRIJAC (Lukian), Lagarde l’Ethiopien, le fondateur de Djiouti (1860-1936), p. 106.
[8] Ibid., p. 76.
[9] PRIJAC, Lagarde, op. cit., p. 107.
[10] Convention relative à la répression de la traite des esclaves dans le sultanat de Tadjourah, passée entre le sultan Hamed ben Mohamed et Lagarde, gouverneur de la colonie d’Obock et dépendances, consultée le 19.09.2025. Cote de communication : 40 COL 879/1, 40 COL 879/1. Cote d’archives : 40 COL 879/1. Identifiant ark : ark:/61561/uq106ey115a. Présentation du contenu : Une copie en français comporte des termes différents de ceux des originaux dans l’intitulé et dans le premier article. Date : 28 octobre 1889. Caractéristiques : 5 copies et originaux.
[11] Notre transcription.
[12] PRIJAC, Lagarde, op. cit., p. 330.
[13] p. 43
[14] MORIN (Didier), Dictionnaire historique afar (1288-1982), p. 257.
[15] p. 46 et p. 51.
[16] MORIN (Didier), Dictionnaire […], op. cit., p. 257.
[17] PRIJAC, Lagarde, op. cit., p. 326 d’après FONTRIER (Marc), Abou-Bakr Ibrahim. Pacha de Zeyla-Marchand d’esclaves.
[18] MORIN (Didier), Dictionnaire historique afar (1288-1982), p. 27